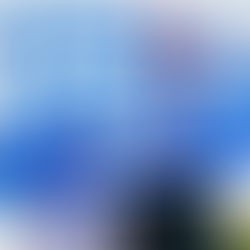En finir avec le libéralisme à la française
C’est une affirmation, pas une question. Elle est celle de Guillaume Sarlat. Un polytechnicien et inspecteur des finances, qui a créé sa société de conseil il y a quelques années.

Il vient de publier un ouvrage [1] qui explique que « si la France est aujourd’hui en crise, c’est parce qu’elle s’est enlisée depuis trente ans dans le libéralisme ». Quand j’écris « explique », je devrais plutôt écrire « tente d’expliquer » ou « croit expliquer ». Car, à vrai dire, je n’ai guère été convaincu par la démonstration.
Tentons tout de même de la comprendre. Guillaume Sarlat est nostalgique des Trente Glorieuses, ces années d’après-guerre où « les gouvernements qui se sont succédé ont suivi un modèle d’économie productiviste, reposant sur un État centralisé et planificateur, intervenant massivement dans l’économie ». Quand François Mitterrand accède au pouvoir en 1981, il continue dans la même voie. On peut même dire qu’il la sublime. « Le programme commun, écrit Sarlat, s’inscrivait parfaitement dans ce modèle et en était même une certaine forme d’aboutissement, avec un effort accru de planification, la nationalisation des industries clés et l’amélioration des droits des travailleurs et de leurs représentants ».
Malheureusement pour Guillaume Sarlat, « dès 1983, le gouvernement socialiste a opéré un renversement complet, pour passer d’une économie dirigée et planifiée à une économie de marché, où le libre-échange était désormais la règle, tout au moins dans une large partie de l’économie ».
Depuis ce tournant de 1983, la France vit, selon Guillaume Sarlat, sous le règne du libéralisme. C’est même « l’une des économies développées les plus ouvertes aux mécanismes de marché, alors même que le pays est pourtant souvent qualifié de viscéralement colbertiste et anticapitaliste ».
Qu’est-ce qui fait, selon Sarlat, que la France est si libérale ? Je cite, pêle-mêle : la privatisation des banques et des principales entreprises publiques, la libéralisation des mouvements de capitaux et des activités de financement, la mise en place d’un « des régimes juridiques et fiscaux les plus favorables en Europe aux montages LBO », un taux d’imposition effectif des grands groupes « relativement modéré ».
Mais il y a, comme qui dirait, un hic car « parallèlement à la libéralisation de l’économie, l’État a considérablement développé les politiques sociales ». C’est Guillaume Sarlat qui l’écrit. Comment alors explique-t-il ce phénomène ? Tout simplement par le fait que « l’État a dû prendre en charge, a posteriori et souvent dans l’urgence, les impacts sociaux du libéralisme, pour que celui-ci reste viable ». C’est ainsi, selon Sarlat, que l’État a développé une « économie parallèle, hors marché et hors libre-échange, et financée par l’impôt » avec « les multiples dispositifs d’emplois aidés dans le secteur non marchand », « les dispositifs de financement en fonds propres hors marché pour les entreprises ne trouvant pas suffisamment de capitaux » (ANVAR, BDPME, FSI, aujourd’hui BPI), « une multitude de dispositifs d’aides et de niches fiscales ».
C’est donc parce que la France est libérale que l’État est contraint de multiplier les dépenses sociales. Elle est même, écrit Guillaume Sarlat, « le premier pays de l’OCDE pour les dépenses publiques sociales, avec 31,9 % du PIB. Elle détient également le record des dépenses publiques parmi les pays développés, avec 57 % du PIB ». Et cet endettement trop lourd, ces dépenses sociales trop importantes ne permettent pas à l’État d’engager les dépenses d’avenir dans « la recherche, l’enseignement supérieur ou les infrastructures ».
Bref, « en libéralisant une partie de l’économie et, parallèlement, en se repliant sur le social et en désertant le champ économique, l’État a laissé la voie libre aux intérêts individuels et aux stratégies opportunistes de chacun des acteurs économiques, que ce soit la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs, les banques commerciales ou les entreprises ».
Voilà donc, en quelques lignes, résumé le premier chapitre de l’ouvrage. Les six chapitres suivants de la première partie ne sont que des développements qui n’apportent rien à la démonstration et qui ne cherchent qu’à « enfoncer » les bêtes noires de l’auteur.
Dans une seconde partie, l’auteur prétend apporter des solutions. Nous n’allons pas non plus nous y attarder. Citons-les tout de même : « sortir des modèles étrangers », « repenser l’économie », « redonner un rôle à l’État », « sortir de la BCE… mais rester dans l’euro », « investir à long terme », « rapprocher CAC 40 et PME », « réconcilier les entreprises avec l’emploi », faire de la France un pays d’actionnaires ».
Osons maintenant quelques critiques. La première porte sur la conception qu’à Guillaume Sarlat du libéralisme. Une vision bien étriquée qui limite le libéralisme à l’économie. Bien entendu, il n’est pas que cela. Le libéralisme, c’est la primauté de l’individu, c’est la liberté pour celui-ci d’agir comme bon lui semble dans la limite de la liberté des autres, c’est la protection des droits individuels face à l’arbitraire et à l’oppression… Le libéralisme, c’est la liberté dans tous les domaines. Comme l’écrivait Benjamin Constant en 1829 : « J’ai défendu quarante ans le même principe, liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique ». Par conséquent, affirmer, comme Guillaume Sarlat, que la France est libérale avec une intervention de l’État tous azimuts, c’est vraiment se fourvoyer.
Deuxièmement, il convient de préciser que si François Mitterrand a changé de politique quelques années seulement après son arrivée au pouvoir, c’est tout simplement que celle qu’il avait menée jusqu’alors avait lamentablement échoué. Il a dû réagir et revenir, un minimum, à la réalité. Il ne l’a pas fait de gaieté de cœur, ni parce qu’il s’était converti à un prétendu libéralisme. Il l’a fait parce que la France était en piteux état, plombée par les dépenses excessives de l’État et l’augmentation inconsidérée du coût du travail.
Troisièmement, l’intervention de l’État dans les entreprises a profondément échoué. Faut-il vraiment rappeler le scandale du Crédit Lyonnais ? L’interventionnisme étatique n’a débouché que sur l’affairisme et la corruption. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ? Faut-il citer, plus près de nous, les difficultés d’Areva, groupe créé de toute pièce par le pouvoir politique en 1983 et dont la gestion s’est révélée ni exemplaire ni performante ?
Quatrièmement, contrairement à ce que semble croire Guillaume Sarlat, l’intervention de l’État dans l’économie ne s’est pas arrêtée en 1983. Elle se porte même, me semble-t-il très bien. L’État ne vient-il pas de racheter des actions Renault au prix fort afin d’être en position de force lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se prononcera sur l’instauration ou non des droits de vote double ? L’État ne s’est-il pas mêlé de la vente de Dailymotion par Orange ? L’État n’est-il pas entré récemment au capital de PSA ? Nous pourrions multiplier les exemples.
Et puis, ce sera le cinquième et dernier point, l’État n’arrête pas de se mêler de la gestion et de la stratégie des entreprises au quotidien. En effet, par la fiscalité et la réglementation, il entend agir sur leurs comportements. J’ai traité de cela dans un précédent article, je n’y reviens pas.
On ne sera pas étonné que Guillaume Sarlat ait dédicacé son ouvrage à Bernard Maris qui devait en écrire la préface, ni qu’Éric Zemmour en ait fait l’éloge dans Le Figaro du 30 avril 2015.
Un ami, à qui je résumais le livre de Guillaume Sarlat, me demandait : « Sur quelle planète vit-il ? » Sur la même que vous et moi, mais pas dans le même pays. En effet, notre auteur a fondé sa société de conseil en stratégie aux entreprises – Sarlat Advisory – à Londres, et c’est de là-bas qu’il la dirige.
[1] : Guillaume Sarlat, En finir avec le libéralisme à la française, Albin Michel, mars 2015.